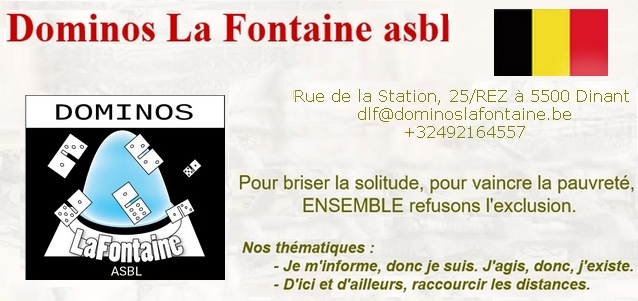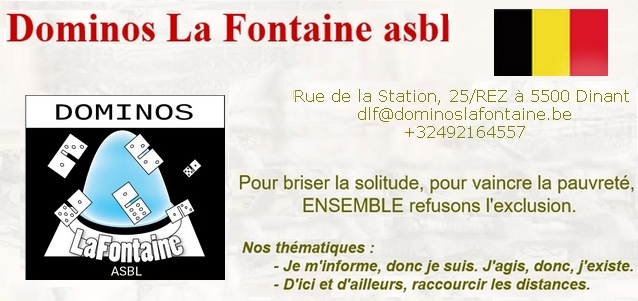Pour voir les détails des activités sur
Facebook, cliquez sur l'image
Pourquoi
ce projet ?
Dans l'ensemble du territoire concerné par le projet, les associations
de lutte contre la pauvreté sont unanimes pour dire que la pauvreté
augmente, alors que l'aide alimentaire est moins facile à trouver. Le
système actuel ne suffit plus pour faire face à l'appauvrissement de la
population. Par exemple, des habitants d'Hastière, la commune la plus
pauvre du territoire, vont demander de l'aide, certains à Givet,
d'autres à Dinant, car les services d'aide de la commune d'Hastière qui
compte plus de pauvres et moins de magasins que Givet et Dinant
disposent de trop peu de vivres à distribuer pour répondre à la
demande. La situation ne peut pas continuer à se dégrader. D'autres
méthodes de lutte contre la pauvreté doivent être créées. Les deux
associations porteuses du projet ont choisi d'expérimenter
l'implication du public cible dans la production d'au moins une partie
de l'aide dont il a besoin. D'autre part, la dégradation de la santé
mentale sur l'ensemble du territoire commun touche plus encore le
public précarisé. Il faut donc pouvoir agir aussi sur cette
problématique. L'état de santé d'une grande partie du public aidé ne
permet pas la (re)mise au travail. Certains, plus âgés, trop malades ne
pourront plus travailler, alors que d'autres ont besoin de passer par
une phase de (re) socialisation, de (ré)insertion pour pouvoir accéder
au marché du travail. De plus, avec l'augmentation de la pauvreté, le
taux de mortalité augmente aussi. Du fait de leurs conditions de vie
difficiles, de la mauvaise nutrition, l'espérance de vie des personnes
précarisées diminue avec la diminution de leurs revenus. Or, le travail
dans la nature, en plein air, en groupe et de la cuisine saine, tout
cela permettra d'améliorer leur santé tant sur le plan physique que
psychique. Les expériences de travail social à la ferme (ici chez un
maraîcher) ont démontré que le contact avec la nature est bénéfique et
a des effets apaisants reconnus tels que la réduction du stress, une
sensation de bien-être, un sentiment d'appartenance et
d'accomplissement qui renforce la cohésion sociale. Le jardinage réduit
l'anxiété, améliore l’estime de soi et diminue le risque de dépression.
Le travail de la terre en groupe favorise la création de liens et le
renforcement de la confiance en soi, des objectifs nécessaires pour
améliorer la cohésion sociale et sanitaire sur le territoire
(thématique 4). D'autre part, la solidarité que les partenaires ne
cessent de développer à travers l'ensemble de leurs réalisations sera
renforcée par le projet qui est un prolongement, un nouvel
aboutissement, de l'ensemble de l'action des partenaires. Les
réalisations du projet créeront des liens concrets, basés sur la
solidarité, mais le bénéfice in fine sera aussi une innovation pour
l'ensemble du territoire : celui d'ouvrir aux pauvres la consommation
d'une alimentation de qualité en circuit court. Le projet sera un
modèle à imiter, à reproduire pour améliorer la condition des personnes
en situation de pauvreté. L'effet sera positif, tant pour la santé
physique que mentale des participants issus de la population fragilisée
du territoire commun
Les statistiques confirment le sentiment d'un appauvrissement des zones
frontalières :- En France, selon l'INSEE, le taux de pauvreté est de
18,3 % dans le département des Ardennes, alors qu'il est de 9,4 % en
Haute Savoie ou de 8,9 % en Vendée. A Givet, le taux de pauvreté est de
26 %. - En Belgique, selon Stabel, le taux de pauvreté est de 17 % en
province" de Namur. Selon Sud Info, à Hastière, il est de 52 % (contre
3 % à la Bruyère, par exemple). Face à l'évidence de la nécessité
d'augmenter les moyens de lutte contre la pauvreté, travailler en
synergie avec des producteurs d'aliments est une voie à développer pour
apprendre de leur expérience, de leur savoir-faire, pour pouvoir
produire de quoi manger et se ressourcer du travail en symbiose avec la
nature, dans une relation de solidarité entre les apprenants et
l'exploitant. Le projet va aussi contribuer à faire connaître le
maraîchage local, à donner un coup de projecteur sur cette profession.
C'est utile, car les maraîchers sont trop peu nombreux dans la région,
surtout les maraîchers bio. Pour faire face au défi de la transition
écologique, leur nombre doit augmenter, afin de produire une offre
suffisante en circuit court. Un des effets du projet pourrait être que
des participants entament une formation en maraîchage, bio, de
préférence. Le projet va mettre en lumière la production locale de
légumes bio et conscientiser la population à l'importance de remplacer
la tondeuse par le jardinage ou le pâturage. Il va rapprocher des
producteurs locaux, soucieux de l'environnement et des consommateurs
qui n'ont pas tendance à se fréquenter. Il va créer ou renforcer des
habitudes de la consommation en circuit court et ouvrir celui-ci à un
public qui en est très éloigné. Il va aussi rapprocher des producteurs
bio locaux transfrontaliers.
Des innovations nécessaires ?
Dans la région de Dinant, le Réseau Radis initié par la Fondation Cyrys
a jeté les bases d'une production locale de produits alimentaires, dont
des maraîchers bio. Ce genre de production reste le privilège d'une
population avertie dont les moyens permettent d'accéder à ce marché. Le
Réseau Radis souhaite impliquer le public précarisé dans son action,
mais le challenge est un défi de longue haleine. Ce projet est une
opportunité d'embrayer dans cette foulée. Une réalisation
transfrontalière de ce moyen innovant de lutte contre la pauvreté sera
enrichie des perceptions respectives de part et d’autre de la
frontière, ce qui donnera du poids à l'action. Au delà de ce projet
temporaire, nous espérons susciter des habitudes pour développer le
concept de travail social à la ferme, plus particulièrement chez les
maraîchers. Concrètement, le projet va mettre en œuvre plusieurs
activités sur plusieurs sites. Sur chacun de ces sites, les
participants seront issus de l'ensemble du territoire. Un maraîcher bio
professionnel, un producteur, accueillera un groupe de participants une
fois par semaine sur son exploitation et il dispensera un apprentissage
qui permettra aux participants de créer dans le futur, leur propre
jardin s'ils le souhaitent. Parallèlement, des ateliers auront lieu
chaque mois, de l'autre côté de la frontière, chez une famille de
paysans maraîchers, également des producteurs bio, ce qui permettra de
comparer les méthodes des deux exploitations. Ces dernières fourniront
les légumes pour l'atelier cuisine géré par une
diététicienne-nutritionniste indépendante. Il aura lieu une fois par
mois. Il aboutira à un "repas solidaire" ouvert aux participants et aux
non-participants, habitués ou non des associations. Ce sera l'activité
d'ouverture à tout public, afin de faire connaître le projet dans la
convivialité. Parallèlement, un travail collectif de conservation de la
mémoire du projet visera à réaliser un guide illustré regroupant les
apprentissages, avec les recettes de cuisines en annexe. Le but de
cette réalisation est de garder une trace du projet dont les auteurs
seront les participants au jardinage et à l'atelier cuisine. Dominos la
Fontaine a déjà réalisé des productions collectives d'expression
culturelle, mais jamais en complément d'un travail manuel.
La combinaison du travail manuel et de la réflexion collective en vue
de la production d'un livre est une innovation expérimentale au niveau
des partenaires. Cette activité sera un plus pour le développement de
la confiance en soi, de la créativité et de l'esprit d'initiative. La
grande innovation du projet est de faire sortir les associations d'aide
et les personnes aidées de la logique d'assistanat en amenant le public
précarisé vers une logique de production, dans un environnement
socialisant et propice à son développement personnel. Le projet va
créer un changement de paradigme au niveau de la lutte contre la
pauvreté en permettant au public précarisé de se réapproprier son
alimentation. En cela, il sera un modèle innovant. Le projet s'inscrit
ainsi également dans un objectif de justice sociale en favorisant
l'accès d'un public précarisé à de la nourriture de qualité. Le projet
va également permettre aux associations partenaires la possibilité
d'offrir un nouveau mode d'accueil, une alternative à leurs actions
traditionnelles. D'autre part, l'organisation du projet veillera à
poursuivre des objectifs de développement durable, par exemple, en
privilégiant les modes de déplacement doux, les transports en commun
et, si ce n'est pas possible, le covoiturage ou le taxi collectif. Ce
projet innovant contribue aussi à l'amélioration de la cohésion
sociale, sanitaire et culturelle en favorisant l'inclusion sociale par
le travail, plus particulièrement le travail en groupe. Il renforce
l'amélioration de la santé par le contact avec la nature, le travail de
la terre. Les activités (le jardinage, la cuisine et un repas
convivial) contribuent à ces objectifs. Elles permettent d'être actif,
de faire de l'exercice, d'être en contact avec la nature, avec d'autres
personnes. Le brassage des populations transfrontalières rapproche les
habitants en améliorant la connaissance des cultures les uns des
autres, ce qui permet de renforcer une identité commune et la
citoyenneté transfrontalière. La participation d'un public
transfrontalier aux différents ateliers va aussi contribuer à
construire la confiance mutuelle, car elle permet d'intensifier les
contacts nécessaires à un sentiment d'appartenance à la région
transfrontalière. Le projet va également renforcer la vie associative
et permettre l'acquisition d'expérience en matière de coopération
transfrontalière. En tant qu'associations partenaires dans ce projet,
nous pressentons un enrichissement réciproque par le partage de nos
expériences. En nous ouvrant au réseau l'un de l'autre, nous sommes
convaincus que nous allons allons élargir nos perspectives.
Des synergies porteuses d'avenir ?
Nous pensons que le partage des expériences, la gestion collective et
participative du projet contribueront à un rapprochement entre la
population visée de part et d’autre de la frontière, ce qui renforcera
le sentiment d’appartenance et l’esprit européens. Les méthodes de
cultures seront respectueuses de la nature, de la biodiversité. Les
actions s'inscrivent dans la logique du Pacte vert européen qui vise
une transition juste et socialement équitable avec pour objectif
d'atteindre la neutralité climatique. Conformément à nos buts et nos
statuts, nous travaillons sur l'objectif de justice sociale. Par ce
projet, nous allons amener le public précarisé, notre public, à
s'impliquer activement dans le cadre de la transition climatique. En
agissant à ce niveau territorial transfrontalier, nous allons pouvoir
créer des synergies et des complémentarités en termes d’actions
concrètes. Ces actions doivent permettre de s’adresser à un
public-cible élargi et concevoir une gamme étendue d’activités en
réponses aux besoins des personnes précarisées. En agissant à ce niveau
territorial transfrontalier nous allons également pouvoir nous
renouveler, nous croiser et/ou approcher des pratiques différentes,
élaborer des référentiels nouveaux /actualisés, développer des
protocoles communs d’intervention. Une approche transfrontalière nous
permet enfin de travailler en complémentarité mais également en
continuité territoriale en regard des publics précarisés, d’accroître
la solidarité et l’accessibilité aux services qui concernent ces
publics. Lutter contre les inégalités et les discriminations doit
contribuer à relever les enjeux sociaux d’ aujourd’hui et de demain Les
avantages que nous, opérateurs du projet et nos usagers et groupes
cibles, pourrions obtenir de cette approche transfrontalière
sont : • La consolidation d’informations transfrontalières
harmonisées concernant la précarité et la pauvreté pour une meilleure
compréhension des réalités sociales. • Le renforcement des
connaissances des différents modes d’organisation à l’œuvre pour une
efficacité accrue des interventions associatives institutionnelles en
matière de lutte contre la précarité • Une meilleure connaissance des
réglementations (juridiques, techniques, etc.) de la culture
administrative, des compétences et/ou de la coordination des actions en
matière de lutte contre la précarité et la pauvreté. • Des réponses à
la nécessité d’adopter des stratégies d’encadrement communes avec une
approche de développement territorial. • Le développement des
méthodologies concrètes visant la construction de logiques de
coopération et de solidarité entre territoires transfrontaliers • Des
réseaux élargis d’acteurs qui se créent et se développent autour des
initiatives sur les territoires. Ces avantages seront inévitablement
sources d'enrichissement réciproque. D'autre, part, l'attrait de
l'ailleurs sera un moteur de motivation, un ressort utile contre la
résignation et l'auto-exclusion très fréquentes chez les personnes en
situation de précarité. Le déplacement transfrontalier exercera une
attractivité bien utile pour vaincre l'inertie due au poids du vécu
difficile des personnes précarisées. Le déplacement transfrontalier
permettra également de démystifier l'ailleurs au profit de l'ouverture
d'esprit et des échanges de pratiques professionnelles. Les communes de
Givet, en France et Hastière, en Belgique sont mitoyennes. Il y a
toujours eu du déplacement entre les deux, mais sans pour autant
vaincre complètement les zones de mystère, d'autant plus
qu'historiquement, Givet a été une ville industrielle avec une forte
immigration algérienne, alors qu'Hastière plus modeste et coquette a
accueilli un abondant tourisme populaire libéré par l'octroi de congés
payés, tandis que Dinant, fière et riche considérait les français comme
des touristes, des clients. Du côté belge, l'immigration est venue bien
plus tard et plus diversifiée en terme d'origines. Ces différences
entre ces villes voisines nécessitent plus d'immersion les uns chez les
autres, afin d'annihiler les préjugés résiduels et partager les
expériences. Par exemple, après une triste période de discrimination
raciale renforcée par la guerre d'Algérie, l'intégration a fini par
réussir à Givet, malgré la désindustrialisation et l'appauvrissement
consécutif, alors qu'à Dinant, l'arrivée d'étrangers de plus en plus
nombreux et l'accroissement de la pauvreté finissent par causer de la
tension. Par contre, la Wallonie résiste à l'extrême droite, alors que
la France s'y engouffre. Le brassage des habitants ne peut que nourrir
une dialogique bénéfique au développement d'une citoyenneté
transfrontalière, gage d'une véritable démocratie européenne. En
restant chacun chez soi, les discussions ne seraient pas aussi riches
et les débats resteraient trop pauvres pour être suffisamment opérants..
Les acteurs du projet :
Le projet vise plus particulièrement les bénéficiaires d'aides sociales
des deux côtés de la frontière et les personnes précarisées en général,
les personnes souffrant de solitude et tout public en besoin de liens.
D'autre part, trois PME sont partenaires du projet : le maraîcher
Amarante.bio à Lisogne (Dinant), Les Potagers de Chooz, Paysans
Maraîchers Utopistes de Chooz et la diétiticienne, nutritioniste Hélène
Daloz Derosière. Les opérateurs du projet sont le Secours Populaire
Français, Comité des Electriciens et Gaziers de la Pointe de Givet et
l'asbl Dominos La Fontaine de Dinant, porteuse du projet. Les
opérateurs sont actifs dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi
dans ce que l'on appelle l'Education populaire en France et l'Education
permanente en Belgique. Ces expertises leur permettent de concevoir une
approche participative et inclusive de l'aide alimentaire.
Les opérateurs remercient la Fondation Cyrys de Dinant pour ses
encouragements, ainsi que pour l'encadrement qu'elle a fourni dans la
conception du projet et pour la traduction.
Début des ateliers à Chooz :
|
|
|
|

|

|

|

|
.